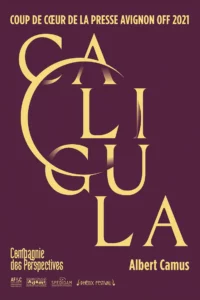La MAC Créteil ouvre sa saison théâtrale avec la création de la pièce la plus énigmatique du répertoire koltésien : Combat de nègre et de chiens présentée dans une mise en scène classique de Mathieu Boisliveau (>), mise en scène singulière en ce qu’elle laisse le spectateur empiéter littéralement sur l’espace de jeu et en ce qu’elle remodèle ainsi le rapport au public en le rapprochant au maximum du jeu physique des comédiens amplement convaincants dans leurs rôles respectifs.
Les textes de Marie-Bernard Koltès ne cessent de nous fasciner par l’ambiguïté de leur dimension quasi métaphysique ainsi que de résister à toute interprétation décisive. Même Patrice Chéreau, qui a le mérite d’avoir familiarisé les spectateurs avec le théâtre de Koltès, ne pouvait prétendre à détenir la clé exclusive de son décryptage définitif : les premières créations des pièces de Koltès par ce metteur en scène incontournable nourrissent indéniablement les nouvelles, et si elles ont pour un certain temps empêché même d’autres metteurs en scène de s’attaquer au théâtre de Koltès en raison de leur haute qualité dramaturgique et esthétique incontestable, elles sont devenues depuis, en plus des textes proprement dits, des repères indispensables qui servent toujours de points de départ fructueux. Si une comparaison avec Chéreau s’impose toujours, il ne s’agit pourtant absolument pas de rivaliser avec lui : sa dramaturgie accessible à travers ses notes et écrits a désormais une valeur historique qui contribue au travail herméneutique mené sur le théâtre de Koltès. Mathieu Boisliveau, intimement attaché à ce théâtre et aux questions qu’il soulève, a su se frayer son propre chemin pour proposer de Combat de nègre et de chiens une relecture personnelle fondée sur une scénographie hyperréaliste.

Dans le propos imprimé sur la quatrième de couverture (Les Éditions de Minuit, 1989), Koltès insiste sur le fait que son Combat de nègre et de chiens n’est pas une pièce sur l’Afrique, le racisme ou le néocolonialisme — même si l’action est située dans un pays d’Afrique de l’Ouest et qu’elle aborde indirectement la question raciale à travers une confrontation directe entre le noir Alboury venu réclamer le corps de son frère mort et le chef de chantier Horn qui biaise pour le lui livrer. La teneur des dialogues nous persuade en effet qu’un étiquetage précipité pourrait nous induire en erreur et réduire la portée métaphysique des propos : l’action intègre certes des thèmes liés au rapport inextricable entre l’Occident/France et l’Afrique, comme au rapport complexe entre les Blancs et les Noirs, mais les dépasse largement en explorant aussi bien les rapports humains entre les quatre personnages de la pièce que le rapport entretenu par chacun d’eux au monde de manière générale : au travers de leur destin singulier, elle conduit à une confrontation féroce de quatre visions du monde qui ont raison de leur impossible entente au-delà de toutes les différences culturelles, sociales, religieuses ou raciales qui les opposent fatalement. Combat de nègre et de chien se présente comme une sombre ode à la vie dans la mesure où les quatre personnages pris isolément débordent certes d’énergie vitale, mais sans parvenir à concilier leurs aspirations dans un compromis acceptable : leurs errances sur le lieu du chantier africain se soldent par une rupture tragique irrémédiable. La mise en scène de Mathieu Boisliveau tient compte de ces enjeux dramatiques et métaphysiques en campant l’action dans un cadre imprécis à cheval entre un désert et un simple chantier.
Plusieurs éléments de décor nous déplacent dans un lieu aride du continent africain sans qu’aucun objet explicite ne nous indique pourtant clairement qu’on se trouve en Afrique, si ce n’est ce sable jaune foncé qui recouvre entièrement la scène et qui n’a en fin de compte qu’une valeur métaphorique ambiguë. A jardin, une sorte de cabane faite en tôle ondulée évoque vaguement le caractère provisoire d’un terrain de chantier : à cour, un grand arbre parsemé de fleurs roses introduit dans cette scénographie aride un élément poétique qui contraste curieusement avec le reste. Si plusieurs rangées de spectateurs sont installées derrière ces deux éléments saillants, une table à jardin et une élévation de terrain à cour se trouvent, quant à eux, sur le devant de la scène. Les quatre angles représentent dès lors chacun un endroit symbolique spécifique pour les besoins de la mise en scène tout en contribuant dans le même temps à circonscrire l’espace de jeu dans un cercle ouvert qui semble dessiner une arène : les rangées de spectateurs placées derrière la scène et les gradins qui leur font face renforcent l’impression que l’aire sablée s’apparente à cette terrible arène où les quatre personnages jouent leur propre destin sous les regards ébahis des spectateurs installés dans leur étroite proximité, pris çà et là pour gardiens. L’action proprement dite semble tiraillée entre les quatre points symboliques en se situant au milieu de la scène à ses moments les plus marquants. L’utilisation dramaturgique de l’espace scénique relève ainsi d’une tension esthétique subtile qui répond au vœu de Koltès selon lequel son Combat de nègre et de chiens « parle simplement d’un lieu du monde ».


C’est ainsi que chaque personnage entretient un rapport différent à ce lieu qui les réunit durant quelques heures. Si le chef de chantier Horn et l’ingénieur Cal l’ont investi depuis longtemps, Alboury et Léone le découvrent à l’instant en s’y rendant l’un pour récupérer le corps de son frère, l’autre pour rejoindre son futur époux, Horn. Or, les rencontres conditionnées précisément par un rapport ambigu à cette terre africaine les précipitent les uns les autres dans une catastrophe sanglante précédée d’échanges tendus qui constituent l’action propre de la pièce : des moments empreints aussi bien de violence et d’angoisse que de poésie et d’espoir, amenés par les quatre comédiens à l’aide d’un jeu assuré et entraînant, devenu haletant dès lors que l’étau se resserre et qu’un ultime règlement de comptes semble inévitable. Soulignons à cet égard qu’un subtil travail sur l’éclairage permet d’augmenter l’intensité de ces moments en instaurant des ambiances variées, ce qui est le plus sensible à ces moments exceptionnels où Léone et Alboury trouvent le chemin l’un vers l’autre pour exprimer leur fascination pour la terre africaine tant malmenée par des intérêts économiques et industriels, à ces moments poétiques où la scène est plongée dans une semi-obscurité bleutée et où l’espoir d’une issue non tragique semble encore possible. C’est le personnage de Léone qui représente l’élément le plus lumineux dont la « profanation » symbolique, l’automutilation et la disparition sonnent le glas de compromis devenus in fine impossibles.

Chloé Chevalier s’empare de la création de Léone avec une sensibilité émouvante : si elle lui prête un air de naïveté en lien avec l’origine sociale de cette parisienne débarquée en Afrique, celle-ci nous séduit tant par sa pureté morale que par l’assurance avec laquelle la comédienne défend les aspirations intimes de ce seul personnage féminin. Denis Mpunga, dans le rôle d’Alboury, incarne le versant masculin de Léone en créant un personnage équilibré doué d’une étonnante sérénité et d’une persévérance inébranlable : Denis Mpunga nous persuade dans le même temps que cette posture n’est pas un signe de soumission mais qu’elle traduit la détermination et l’honnêteté pudique d’Alboury. A l’autre bout de l’échelle des valeurs humaines, Thibault Perrenoud prête son corps au cynique ingénieur Cal, âprement attaché au gain et au bien-être : il l’incarne avec une agitation fiévreuse traduisant les frustrations de ce personnage en perte de repères entraînés par une errance stérile qui précipite les autres dans le mal. Pierre-Stefan Montagnier, dans le rôle de l’homme de compromis par excellence, incarne son personnage avec un air de bonhommie tenace en nous convainquant que l’échec des actes bien intentionnés d’Horn est imputable au louvoiement et au manque de fermeté.
Combat de nègre et de chiens dans la mise en scène de Mathieu Boisliveau est une création entraînante qui tient les spectateurs en haleine pendant les deux heures que dure le spectacle : elle relève d’une relecture personnelle sensible tout en servant le texte de Koltès avec adresse. Elle nous séduit dans le même temps par le jeu maîtrisé des quatre comédiens qui s’approprient leurs personnages avec aisance. C’est un moment intense avec le théâtre de Koltès.
 Le théâtre de Jean-Luc Lagarce s’empare de la vie des gens ordinaires pour représenter leur quotidien situé dans un hors-temps dramatique. Ses personnages dessinés avec une touche hyperréaliste nous interpellent à travers des tensions qui les hantent sans conduire à une véritable catastrophe tragique au sens classique du terme : il reste quelque chose à régler entre eux, et c’est ce qui les réunit au passage, mais pas inévitablement, sans qu’ils parviennent tout à fait à s’entendre pour trouver un compris. Le théâtre de Jean-Luc Lagarce saisit précisément ces instants délicats qui ébauchent en sourdine une crise profonde : des conversations entamées, juxtaposées par le dramaturge dans leur linéarité, se suivent comme si elles étaient prélevées sur le quotidien des personnages sans nous éclairer entièrement sur les raisons de cette crise susceptible de verser à tout moment dans une catastrophe qui entraîne une rupture définitive. C’est ainsi que des bribes d’un passé évoqué par intermittence s’introduisent dans des échanges sans inscrire pour autant l’action dans un temps historique : tout reste dans un état d’indétermination qui crée un savoureux mystère. Cette indétermination traduit dans le même temps l’échec d’une rationalisation dramatique comme celui d’un arrangement conformiste, rationalisation et arrangement qui sont l’apanage des représentations de la société bourgeoise.
Le théâtre de Jean-Luc Lagarce s’empare de la vie des gens ordinaires pour représenter leur quotidien situé dans un hors-temps dramatique. Ses personnages dessinés avec une touche hyperréaliste nous interpellent à travers des tensions qui les hantent sans conduire à une véritable catastrophe tragique au sens classique du terme : il reste quelque chose à régler entre eux, et c’est ce qui les réunit au passage, mais pas inévitablement, sans qu’ils parviennent tout à fait à s’entendre pour trouver un compris. Le théâtre de Jean-Luc Lagarce saisit précisément ces instants délicats qui ébauchent en sourdine une crise profonde : des conversations entamées, juxtaposées par le dramaturge dans leur linéarité, se suivent comme si elles étaient prélevées sur le quotidien des personnages sans nous éclairer entièrement sur les raisons de cette crise susceptible de verser à tout moment dans une catastrophe qui entraîne une rupture définitive. C’est ainsi que des bribes d’un passé évoqué par intermittence s’introduisent dans des échanges sans inscrire pour autant l’action dans un temps historique : tout reste dans un état d’indétermination qui crée un savoureux mystère. Cette indétermination traduit dans le même temps l’échec d’une rationalisation dramatique comme celui d’un arrangement conformiste, rationalisation et arrangement qui sont l’apanage des représentations de la société bourgeoise.


 La Ménagerie de verre, l’une des plus fameuses pièces de
La Ménagerie de verre, l’une des plus fameuses pièces de