 Jean Zay, l’homme complet est une création originale fondée sur la relecture scénique de ses Souvenirs et solitude, écrits en prison et publiés pour la première fois en 1945. C’est le comédien Xavier Béja qui les adapte pour le théâtre tout en incarnant l’homme politique d’envergure oublié. Il confie la mise en scène de son travail d’adaptation à Michel Cochet qui en propose un spectacle épuré aussi captivant que bouleversant, spectacle créé en février 2022 à Anis Gras-Le Lieu de l’Autre (Arcueil), repris au Festival d’Avignon 2022 et 2023 et remis à l’affiche en cet hiver 2024 au théâtre Essaïon où il se joue à guichets fermés (>).
Jean Zay, l’homme complet est une création originale fondée sur la relecture scénique de ses Souvenirs et solitude, écrits en prison et publiés pour la première fois en 1945. C’est le comédien Xavier Béja qui les adapte pour le théâtre tout en incarnant l’homme politique d’envergure oublié. Il confie la mise en scène de son travail d’adaptation à Michel Cochet qui en propose un spectacle épuré aussi captivant que bouleversant, spectacle créé en février 2022 à Anis Gras-Le Lieu de l’Autre (Arcueil), repris au Festival d’Avignon 2022 et 2023 et remis à l’affiche en cet hiver 2024 au théâtre Essaïon où il se joue à guichets fermés (>).
L’une des vertus attribuées au théâtre par les philosophes des Lumières est celle d’instruire, et dans le cas de Jean Zay, l’homme complet le théâtre accomplit bel et bien cette mission en nous laissant découvrir un homme politique fâcheusement tombé dans l’oubli. Ministre de l’Éducation nationale et des Beaux-Arts (1936-1939) dans le gouvernement du Front populaire, Jean Zay met en place plusieurs réformes emblématiques qui structurent toujours nos institutions et les parcours scolaires : entre autres, il institue les trois degrés d’enseignement ou le sport à l’école, il crée le CNRS mais aussi le festival de Cannes, et donne enfin l’idée de la future ENA qui vit le jour après la guerre. Poursuivi par le régime de Vichy pour avoir participé au débat sur le transfert du gouvernement en Afrique du Nord ainsi que pour être parti à Casablanca, il est arrêté, accusé de désertion et incarcéré (août 1940) avant d’être tué par les Milices (juin 1944). Derrière cette précieuse dimension didactique se révèle pourtant un spectacle à part entière qui met à nu avec sensibilité non seulement l’histoire tragique d’un homme politique déchu, mais aussi le destin brisé d’un être humain en proie à une solitude poignante.
Le spectacle repose sur la mise en voix du récit de Jean Zay tiré de ses Souvenirs et solitude, récit qui suit une trajectoire épique en allant de l’incarcération à la prison militaire de Clermont-Ferrand à l’évocation de l’assassinat à 39 ans dans un bois dans l’Allier. Le travail dramaturgique tient pourtant à l’assouplissement d’une narration purement didactique au profit d’une épaisseur lyrico-métaphysique. Dans ses écrits, Jean Zay se laisse en effet aller à un certain épanchement sentimental qui le conduit à réfléchir en catimini sur l’extraction d’un individu de la société et par-là sur l’insignifiance déchirante de l’existence de cet individu disparu sans conséquence d’un jour à l’autre, sur cette terrifiante constatation intimement mêlée au sentiment de solitude. Ces interrogations existentielles confèrent à Jean Zay, l’homme complet une immense profondeur humaniste qui le fait sortir d’un didactisme apparent. Xavier Béja et Michel Cochet ont ainsi réussi à instaurer une subtile tension dialectique entre instruction et émotion, afin d’œuvrer sur la fibre sensible du spectateur et de provoquer chez ce dernier une délectable compassion spirituelle.

La scénographie renforce la dimension intimiste propre à une forme de confidence scénique. Sans adresse explicite faite aux spectateurs, Jean Zay apparaît comme un revenant en chair et en os sur un plateau nu dans la pénombre d’une cellule de prison pour faire implicitement part de ses souffrances morales et existentielles. Quelques projections sur le fond de la scène introduisent subtilement dans son récit des repères historiques indispensables tels que les dates, mais aussi des extraits vidéo illustrant poétiquement le contexte des événements personnels narrés et ce, pour favoriser le libre cours donné à l’expression des états d’âme de l’être humain souffrant. D’abord une simple chaise, ensuite une table à écrire redynamisent chacune à son tour le spectacle aux accents lyriques en structurant efficacement le récit de Jean Zay en plusieurs étapes épiques arrêtées en fonction de l’évolution de sa situation de prisonnier militaire. Aussi une étonnante harmonie obtenue entre une scénographie dépouillée et un récit de souvenirs instaure-t-elle un palpitant sentiment de communion entre la scène et la salle. Il y a quelque chose d’indicible qui saisit les spectateurs en les affectant dans leurs sensibilités.
Michel Cochet met astucieusement en place une action entraînante qui parvient à nous imposer la présence de Jean Zay avec une conviction frappante : cette action mêle finement des moments d’effusions lyriques et de réflexions métaphysiques à des souvenirs antérieurs d’homme politique, des moments extrêmement intimes à des récits ardents évoquant une brillante carrière. L’équilibre entre ces deux pôles étroitement complémentaires relance sans s’épuiser l’intérêt des spectateurs pour le destin de Jean Zay brillamment interprété par Xavier Béja. Le comédien s’empare de la création de son personnage en lui donnant une prestance tout à fait juste suivant les variations de tonalité recherchées : autant il semble une pâle ombre de lui-même pour rendre authentique la torpeur qui envahit Jean Zay à certains moments critiques de sa captivité, autant il sait s’enflammer de passion pour communiquer ses convictions politiques à des moments empreints d’espoir. Ce faisant, Xavier Béja donne vie à son personnage sans basculer ni dans le pathétique ni dans la caricature, il se confond aisément avec lui comme si Jean Zay revenait chaque soir de l’au-delà pour méditer le tragique de la condition humaine.
Jean Zay, l’homme complet se présente dès lors comme un saisissant seul-en-scène tant par le travail d’adaptation qui nous fait découvrir un personnage historique notable que par son interprétation émouvante. C’est un spectacle intime mémorable qu’il faut absolument voir.
 Jean, une vie de La Fontaine est une création originale de Thierry Jahn de la Cie Bigarrure, donnée actuellement au Théâtre Essaïon (
Jean, une vie de La Fontaine est une création originale de Thierry Jahn de la Cie Bigarrure, donnée actuellement au Théâtre Essaïon (
 Rembrandt sous l’escalier est une nouvelle pièce de l’écrivaine et dramaturge Barbara Lecompte, présentée au Théâtre de l’Essaïon (
Rembrandt sous l’escalier est une nouvelle pièce de l’écrivaine et dramaturge Barbara Lecompte, présentée au Théâtre de l’Essaïon (
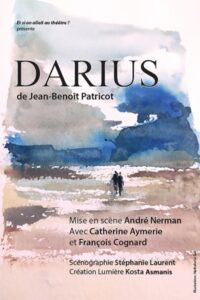 Darius, à l’affiche au Théâtre de l’Essaïon, est une pièce de Jean-Benoît Patricot présentée dans une mise en scène émouvante d’André Nerman (
Darius, à l’affiche au Théâtre de l’Essaïon, est une pièce de Jean-Benoît Patricot présentée dans une mise en scène émouvante d’André Nerman (


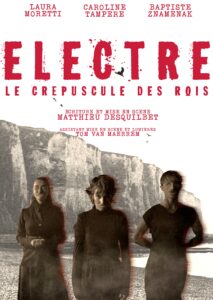 Remarquée au Festival des Hivernales 2022, et programmée au théâtre de l’Essaïon au cours de l’été et de l’automne de la même année (
Remarquée au Festival des Hivernales 2022, et programmée au théâtre de l’Essaïon au cours de l’été et de l’automne de la même année (


