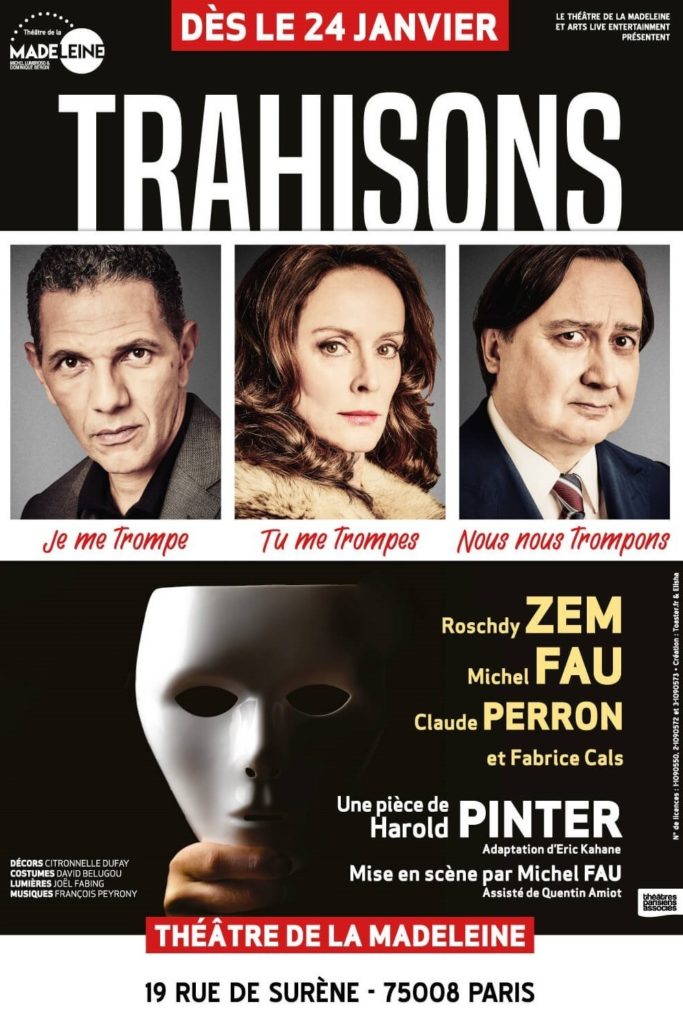Un tramway nommé Désir est l’une des plus célèbres parmi les pièces de Tennessee Williams. Mise en scène par Manuel Olinger, elle est jouée au théâtre La Scène Parisienne (>).

Un tramway nommé Désir est devenue aujourd’hui une pièce mythique que tout amateur du théâtre connaît pour l’avoir lue ou pour avoir vu son adaptation cinématographique d’Elia Kazan avec Vivien Leigh et Marlon Brando. Pour les spectateurs avertis ou des connaisseurs inconditionnels de l’œuvre bouleversante de Tennessee Williams, toute nouvelle mise en scène apparaît ainsi comme une opération très délicate de reprise ou de renouvellement. Il n’est en effet pas évident de proposer une interprétation tant soit peu originale sans trahir le soi-disant esprit de la pièce. Reproduire ou restituer simplement est une démarche plate qui ne suscite pas l’enthousiasme du public. Revoir le texte de fond en comble et élaborer une mise en scène décapante risquent au contraire d’agacer parce que le spectateur peut avoir l’impression de ne plus retrouver sa Blanche, sa Stella et son Stanley (Un tramway de Warlikowski, Odéon, 2010). L’entreprise dramatique de Manuel Olinger se situe davantage du côté de la restitution à la recherche de la couleur locale et des émotions fortes. Comme « l’adaptation cinématographique ne correspondait pas à la vision qu[’il] avai[t] de l’œuvre, trop actée sur la relation de Blanche et Stanley, » il souhaitait nous donner la version de la pièce revue selon sa lecture personnelle. Dans cette reprise d’Un tramway nommé Désir, Manuel Olinger travaille donc sur les relations entre tous les trois personnages principaux tout en redorant le blason de Mitch. Son avantage est d’avoir à sa disposition des comédiens qui parviennent aisément à entrer dans leur rôle et à les porter à la scène : Julie Delaurenti (Blanche), Murielle Huet Des Aunay (Stella), Manuel Olinger (Stanley Kowalksi), Gilles Vincent Kapps (Michtell) et Jean-Pierre Olinger (Steve et saxophoniste). Mais la mise en scène en tant que telle suscite d’abord quelques réserves quant à son originalité.
Le regard d’un spectateur averti reconnaît rapidement la disposition de l’espace scénique constitué des éléments de décor qui figurent l’appartement exigu et modeste de Stella et Stanley. En balayant la scène de gauche à droite, on remarque un balcon en fer forgé mobile, un vieux lit de fer couvert de draps clairs, derrière lequel une commode rouge foncé est remontée d’un miroir, ensuite une table blanche avec quatre chaises, une salle de bain, visible au fond de la scène, derrière une paroi avec un petit placard de rangement, un lit pliable, enfin un petit escalier d’entrée. Ces meubles usés témoignent bien des conditions matérielles dans lesquelles vivent les Kowalski et amènent l’ambiance de la Nouvelle-Orléans des années 40. Mais comme la scénographie construit l’espace scénique en suivant fidèlement les indications du dramaturge, elle n’offre finalement au regard du spectateur qu’un cadre banal sans invention particulière et ne tient qu’à la recherche de la couleur locale.
Cette recherche de la couleur locale est d’autre part soutenue par le choix des costumes : conformément à l’espace scénique historicisant, les personnages sont habillés selon la mode de l’époque. Stanley porte un pantalon noir et un t-shirt noir assorti çà et là d’un gilet. Stella, quant à elle, doit se contenter de vêtements modestes mais jolis et qui ne manquent pas de relever sa féminité. La garde-robe de Blanche censée rentrer dans les deux malles avec lesquelles elle débarque chez les Kowalski impressionne tout de même par sa variété clinquante. Elle est constituée de costumes classiques propres à la profession d’une professeur d’anglais, mais aussi de robes de soirée élégantes pour sortir et qui contrastent avec l’appartement des Kowalski. L’habillement des personnages renforcent ainsi l’impression d’assister à une mise en scène qui s’appuie sur un décor réaliste porté à une plate appréciation esthétique : le cadre matériel ne sollicite pas davantage l’imagination du spectateur. C’est en revanche le jeu des comédiens qui le fait réellement vibrer.
La lecture de la pièce conduit le spectateur à se représenter Stanley comme un mâle dominant qui n’est pas très raffiné et qui est tout l’opposé de l’univers originel des deux sœurs. C’est ce personnage que Manuel Olinger tente de faire renaître sur scène et ce, avec succès : sa stature, les mouvements brusques mais sûrs ainsi que les inflexions profondes de sa voix de baryton rendent crédible la création de son personnage. À l’instar de Marlon Brando, il joue cruellement avec Blanche en la pourchassant sans répit comme un gros chat poursuit une petite souris fragile à la recherche d’un endroit sûr. C’est ce jeu fascinant que Manuel Olinger parvient à imposer à Julie Delaurenti qui s’ébat désespérément entre ses mains jusqu’à un départ forcé. La présence imposante de Stanley se fait sentir dans les postures incertaines de Julie Delaurenti même quand il n’est pas sur scène. Manuel Olinger monte dans les degrés à tel point que le spectateur n’est jamais vraiment sûr de ce qui va se produire même s’il connaît la suite. Mais si Stanley parvient à protéger son territoire devant l’intrusion de la sœur manipulatrice qui met à mal l’harmonie brisée de son couple, celui de Manuel Olinger paraît plus agressif et beaucoup moins rêveur par rapport à celui de Marlon Brando. Julie Delaurenti, quant à elle, crée une Blanche légèrement hystérique et plus nerveuse, plus déstabilisée que ne le fait Vivien Leigh : sa Blanche est moins lunatique et semble assumer davantage ses mensonges dont elle se sert pour cacher sa chute tragique. Le raffinement et l’innocence apparente de Vivien Leigh cèdent le pas à une interprétation plus crue, plus animale, plus expressive de sorte que Julie Delaurenti donne à sa Blanche une dimension plus humaine.
Quant au personnage de Stella, dans le film d’Elia Kazan, l’actrice qui l’incarne a l’air largement naïve : elle semble croire aux mensonges et à l’innocence de Blanche. L’interprétation de Murielle Huet Des Aunay est plus nuancée. Certes, Stella défend sa sœur contre les accusations de Stanley comme l’indiquent les répliques, mais l’inquiétude que l’on observe dans le jeu de Murielle Huet Des Aunay nous persuade que Stella cherche plus à protéger sa sœur chérie qu’elle n’adhère à ses propos fallacieux. Cette inquiétude combinée à une certaine réserve suggère que Stella se doute que tout n’est pas comme Blanche le raconte. Murielle Huet Des Aunay construit donc un personnage moins partial et plus profond. On est impressionné par la sensibilité avec laquelle elle prête son corps à Stella partagée entre l’amour de Stanley et celui de Blanche.
Le jeu des acteurs relève donc la scénographie qui reproduit platement les codes esthétiques d’antan. On prend un vrai plaisir à retrouver sur scène Stanley, Stella et Blanche dans des interprétations plus nuancées par rapport au film d’Elia Kazan. Ce constat montre en même temps qu’Un tramway nommé Désir n’est pas une pièce facile à monter : la porter à la scène représente un véritable défi tant pour un metteur en scène et son scénographe que pour des comédiens.