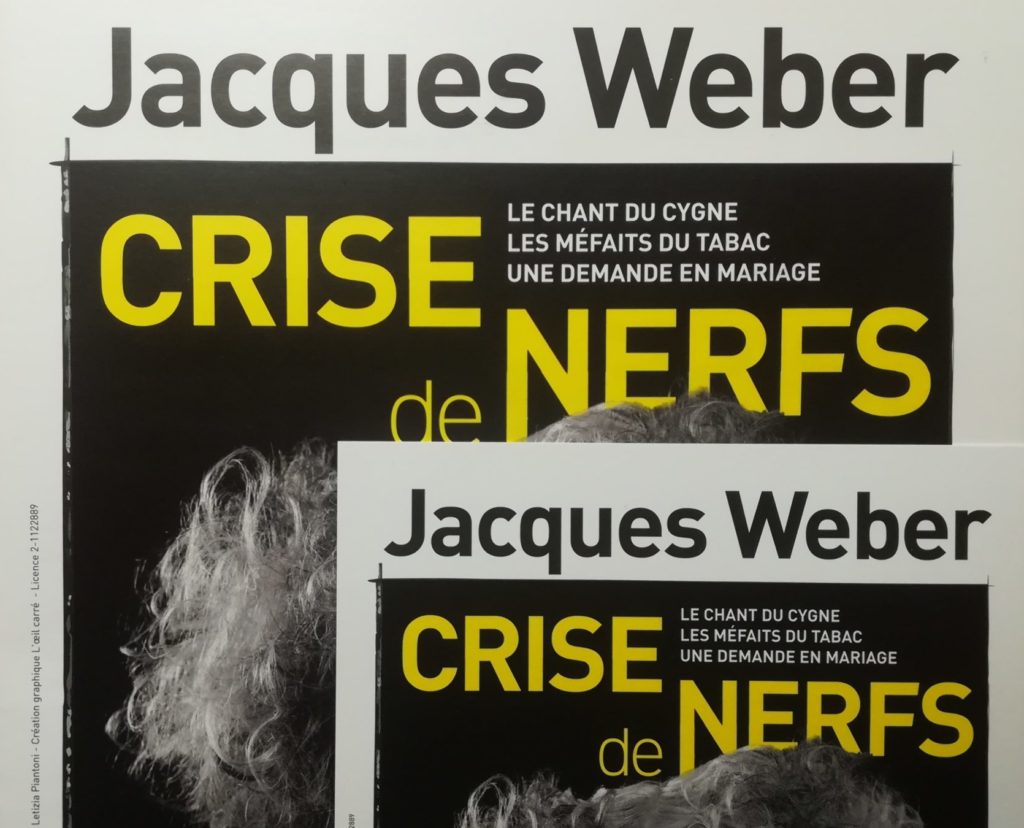Après plusieurs annulations ou reports, La Ménagerie de verre mise en scène par Ivo van Hove au théâtre de l’Odéon pour le début mars 2020 a été remise à l’affiche le 25 mai 2021 (>). On retrouve dans le rôle de la mère la merveilleuse Isabelle Huppert pour laquelle ce rôle est une véritable fête.
La Ménagerie de verre (The Glass Menagerie, 1944), qui est une des premières pièces de Tennessee Williams, est déjà un de ses chefs-d’œuvre. Pour cette pièce intime présentée par le personnage du fils comme un souvenir, le dramaturge américain débutant s’inspire de la situation de sa propre famille tout en redessinant des relations complexes entre Amanda et ses deux enfants, Tom et Laura. Chaque personnage vit enfermé dans un univers sublimé qu’il protège à sa manière : Laura, infirme et en manque de confiance chronique, chérit une collection de bibelots en verre ; Tom rêve d’une vie d’aventure en passant des soirées entières à regarder des films au cinéma ; Amanda, quant à elle, vit accrochée à l’âge d’or de sa jeunesse passée. C’est de cet arrière-plan familial que se dégage discrètement toute une problématique sociale liée autant au désir d’une ascension pour les uns qu’à la déception ou au désœuvrement pour d’autres. Si Amanda souhaite une réussite professionnelle pour ses enfants tous les deux en échec tout en essayant de stimuler leurs ambitions éteintes, seul le fils travaille, sans état d’âme, dans une usine pour pourvoir aux besoins de la famille délaissée par le père parti en voyage et disparu depuis sans autre trace qu’une carte postale laconique envoyée du Mexique. En plus d’un triple drame humain façonné avec une rare finesse, l’action se déroule ainsi sur le fond des tensions sociales qui affectent les classes moyennes des années 30 gagnées par l’espérance illusoire d’une vie meilleure. Le dramaturge ordonne le déroulement de l’action en le pensant avec une telle précision psychologique que la moindre erreur de mise en scène risque de la déséquilibrer et de la rendre lourde. Pour réussir à monter une pièce de Tennessee Williams, et d’autant plus La Ménagerie de verre qui se joue dans l’intimité la plus étroite de trois personnages, tout travail de création scénique exige la même précision dans son interprétation. Pour ne pas basculer dans un mélodrame boulevardier, aucun droit à la négligence ou à la précipitation n’est accordé à celui qui s’y hasarde. Ivo van Hove met ainsi avec pertinence l’accent sur le caractère « intérieur » de la pièce tout en l’inscrivant dans une scénographie singulière. L’attention qu’il sait porter au moindre détail était dans son cas une promesse de réussite. Et le célèbre metteur en scène flamand ne déçoit pas : il est parvenu à créer, grâce à sa rigueur, une mise en scène empreinte d’une remarquable poésie scénique qui convainc le spectateur de sa justesse.
Comme l’indique le texte, la scène représente l’appartement d’Amanda et de ses enfants. Seule la cuisine située dans un renfoncement côté jardin, délimitée par un plateau bar, se démarque du reste : c’est un espace presque exclusivement occupé par Amanda, rares étant les moments où d’autres personnages y pénètrent comme le fait Tom lors d’une violente dispute au début de l’action. Une sorte de coin chambre côté cour semble symboliquement réservé à Laura : on y remarque quelques coussins, une couverture, un tourne-disque et un espace de rangement fait dans le mur pour la ménagerie de verre. Tom ne dispose curieusement d’aucun endroit intime, et c’est également lui qui sort le plus souvent par l’escalier d’incendie du milieu, ce qui semble préfigurer son désir d’émancipation et sa fuite finale. L’escalier d’incendie qui sert d’entrée dans l’appartement et une fenêtre placée à côté suggèrent vaguement un extérieur prometteur d’une vie meilleure. Le devant de la scène, enfin, représente occasionnellement une terrasse où les personnages sortent pour discuter ou rêver au clair de lune. La hauteur a par ailleurs été considérablement réduite pour accentuer l’intimité de l’appartement, si bien que le spectateur a l’impression d’avoir sous les yeux une sorte de cage oblongue. Une telle impression est renforcée par le fait que le sol et les murs sont entièrement recouverts d’un tissu fourrure marron aux esquisses superposées du visage obsédant du mari et père disparu. Si cette scénographie étonnante devient pleinement révélatrice de la vie intime des personnages, elle s’impose surtout comme une réminiscence figurative de la mémoire de Tom, composée des éléments les plus significatifs susceptibles de constituer une fresque-souvenir. Ivo van Hove répond par-là à la volonté du dramaturge exprimée par Tom dans son monologue du début de l’action : offrir au spectateur « la vérité affublée du masque plaisant de l’illusion ». Ce monologue initial, accompagné d’un tour de magie, opère en même temps un retournement esthétique pour introduire le spectateur dans une réalité théâtrale présentée pour ce qu’elle est : un récit-rétrospectif, ce qui permet de faire passer la fiction pour une vérité extériorisée sur scène. C’est Antoine Reinartz dans le rôle de Tom qui sert ici de passeur.
Les comédiens transcendent l’espace de jeu en le transformant en un cocon protecteur baigné d’illusions malgré la misère de la famille évoquée dans de nombreuses répliques. Ils ont su lui insuffler, sous les yeux ébahis d’un spectateur touché, une chaleur humaine suggérée d’abord avec ambiguïté par le marron du tissu fourrure. La poésie de plusieurs scènes, entérinée par un éclairage tamisé et une bande musicale de fond, l’imprègne de cette impression d’un bonheur évanescent que l’on sait qu’il ne pourra pas durer une fois la pièce terminée et ce, du moment que Tom révèle à Jim invité pour être présenté à Laura qu’il compte partir, quitte à laisser sa mère et sa sœur sans ressources. Cette belle scène où Amanda, réconciliée avec son fils et confiante en ses capacités, l’incite à faire un vœu au clair de lune s’empreint a posteriori d’une émouvante ironie tragique : bras dessus, bras dessous, Amanda et Tom, assis sur le devant de la scène, ont les yeux rivés sur le fond de la salle, d’où vient la lumière, dans une complicité touchante.
Le moment particulièrement intense représente le tête-à-tête entre Jim et Laura passé à la bougie à cause d’une coupure d’électricité intervenue à la suite d’une facture non payée par Tom : la pénombre mêlée au doux crépitement de gouttes de pluie retenues dans des pots disposés sur le sol suscite une émotion élevée lors de ces quelques instants exquis vécus par Laura décomplexée par les propos de Jim. Justine Bachelet a su donner à Laura l’allure d’une jeune fille fragile grâce à la coloration grave de sa voix et ses gestes timides, alors que Cyril Guei crée, à travers son personnage, un excellent cliché qui correspond à la représentation stéréotypée d’un jeune américain issu du milieu ouvrier mais confiant en son avenir : ses yeux brillants, sa voix posée et sa posture assurée donnent à ce Jim de Cyril Guei un indéniable charme qui attire les jeunes filles. Les ombres entraînées par les corps des deux comédiens ainsi que des reflets venant des figurines de verre subliment ainsi les confidences des deux personnages dans une acmé pittoresque imprégnée d’une profonde tristesse. La révélation précédente des fiançailles de Jim avec une certaine Betty rend cependant le bonheur de Laura quelque peu amer tout en alertant le spectateur sur son caractère cruellement illusoire à travers toute la splendeur figurative de cette scène qu’on espère voir durer sans fin.

Isabelle Huppert, quant à elle, crée une mère douée d’une énergie infernale relevée d’un remarquable sens de la repartie : son débit rapide, sa voix pénétrante et ses gestes à la fois souples et maîtrisés l’imposent comme un habile chef de famille qui tient le ménage. Son Amanda persuade qu’elle domine Tom et Laura non seulement à travers la teneur de ses répliques, mais surtout grâce à une sorte de surprésence omnipotente de la comédienne. Son excellente interprétation de la mère naît enfin de cette impression que l’on ne parvient pas à savoir si les manipulations d’Amanda sont pleinement conscientes ou si elles font simplement partie du tempérament extroverti de la mère : un délicieux doute persiste qui ne permet de trancher à aucun moment du spectacle. Isabelle Huppert donne le meilleur de son talent dans la création de son personnage pour tenir en haleine le spectateur enchanté tout au long de la représentation.
La Ménagerie de verre d’Ivo van Hove s’est fait attendre pendant de longs mois pour être enfin littéralement offerte aux spectateurs, comme par magie, à l’occasion de la réouverture des théâtres : la qualité de la mise en scène et l’excellence de tous les comédiens ont ainsi ménagé une émotion intense augmentée par le plaisir de retrouver les salles.