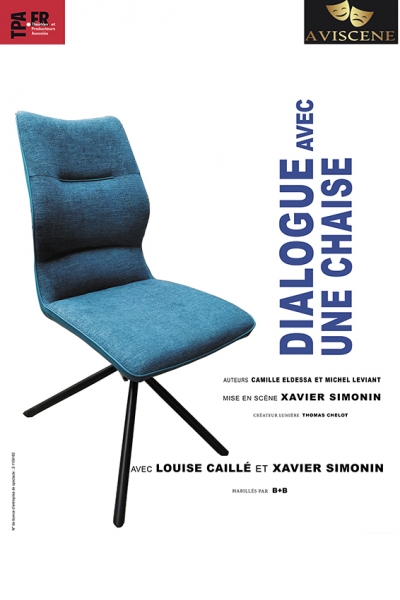Le Petit Chaperon rouge de Joël Pommerat est une réécriture théâtrale du célèbre conte inscrit depuis des siècles dans la mémoire culturelle. Et cette réécriture est loin d’être la première en date : après Gripari ou Grumberg, le metteur en scène, devenu mythique en l’espace de quelques années, vient en 2004 avec sa propre version créée par la compagnie Louis Brouillard au Théâtre Brétigny. Depuis lors, son Petit Chaperon rouge ne cesse de sillonner la France pour être joué et rejoué avec un succès durable. Cette fois-ci, il a été remis à l’affiche par le Théâtre-de-la-Ville au Théâtre-Paris-Villette. Et c’est toujours fascinant de redécouvrir cette création et de faire une sorte d’archéologie dans les recherches de Joël Pommerat.
L’acte de réécriture ou d’adaptation pour le théâtre est un acte de toute époque. Si ce sont généralement l’histoire et la mythologie qui font l’objet de cette démarche, c’est moins le cas des contes, destinés aux enfants et considérés par-là comme pas assez sérieux pour intéresser les adultes lors d’une sortie au théâtre. Un conte philosophique suscite au reste lui aussi la même dévalorisation et la même méfiance au regard des invraisemblances qu’il concentre copieusement pour diffuser des idées et semer des polémiques sur un mode détourné. Cette dévalorisation des contes écrits est liée aux enjeux esthétiques de leur apparition dans les années 1690, lorsque leur mode fut lancée par le succès de ceux de Mme d’Aulnoy. S’ils ont été sauvés du discrédit qui les frappait, c’est parce qu’ils ont trouvé une débouchée idéale dans un public enfantin en raison de leur prétendue dimension didactique soulignée dans plusieurs préfaces d’auteur. Qu’il s’agisse enfin de contes entièrement inventés ou de récits traditionnels transmis par la voie orale et mis en écrit à un moment donné, les mécanismes narratifs sur lesquels ils reposent interrogent avec la même acuité notre rapport ambigu à l’autre et à la différence. C’est le caractère anthropologique de ce rapport qui se trouve au cœur de l’acte de réécriture en plus des questions dramaturgiques liées à la représentation théâtrale.
Comme ceux qui s’y sont prêtés avant lui, Joël Pommerat réécrit un conte ancien en le modernisant pour intégrer à sa trame narrative des hantises de la société contemporaine. Sans dénaturer le conte originel ou ce qui passe pour tel selon la version retenue (en général celle de Perrault ou celle des frères Grimm), il modifie la situation sociale des personnages en imaginant que le Petit Chaperon rouge vit avec sa mère dans une famille monoparentale sans mentionner l’absence du père : et comme la mère travaille beaucoup, la fille se retrouve souvent seule de la même manière que la grand-mère qui, délaissée, habite loin de chez elles. Ce faisant, Joël Pommerat introduit dans le conte des clins d’œil faits aux préoccupations existentielles de la société occidentale du début du XXIe siècle : l’émancipation et la solitude. Sans aucun parti pris sociologique, il redessine ainsi les conditions dans lesquelles évolue l’histoire du Petit Chaperon rouge en proie au désir d’agir comme les adultes et exposé en même temps à des dangers qui nous rappellent subrepticement ceux des enfants de notre époque. La rencontre avec le loup, sans les exacerber, figure ensuite ces dangers de façon allusive. La réécriture du Petit Chaperon rouge par Joël Pommerat nous tend un miroir magique pour nous parler de nous-mêmes, en demi-teinte et de façon énigmatique, à travers des suggestions feutrées.
La scénographie et les lumières prolongent magnifiquement cet effet de mystère inscrit dans l’histoire. L’aménagement de l’espace se distingue par sa nudité plongée dans une semi-obscurité angoissante. Seules deux chaises qui se font face au milieu de la scène constituent des éléments de décor qui réfèrent à notre monde, pour suggérer sans doute l’idée que l’action débute dans la maison de la mère du Petit Chaperon rouge et que la petite fille y reste souvent seule. Mais ce n’est qu’une impression vague qui nous traverse l’esprit au regard des propos du narrateur et des scènes mimées en parallèle. Et le spectateur s’en contente sans la questionner davantage en sachant que l’action portée sous ses yeux est le fruit de l’imagination et de sa matérialisation sublimée dans des tableaux qu’il peut croire sortis d’une lampe à histoires. Cette imprécision spatio-temporelle relève du fait que les contes se situent dans un passé imaginaire, dont l’indice par excellence est la formule d’amorce « il était une fois ». La nudité du plateau et la semi-obscurité maintenue tout au long de la représentation s’imposent comme la traduction matérielle de ce surgissement inexplicable de l’univers merveilleux sur scène afin de réactiver des fantasmes des spectateurs. Sans chercher à se faire passer pour ce qu’elle n’est pas, l’action scénique se présente ainsi comme éminemment théâtrale.

Cette théâtralité se manifeste d’abord à travers la mise en voix du récit pris en charge par un narrateur vêtu d’un costume-cravate contemporain, fait dans des couleurs grises. Pendant ce temps, Le Petit Chaperon rouge, rejoint par sa mère peu après l’exposition de sa situation, se laisse aller à un jeu de mime pour illustrer les propos énoncés. Quand par exemple le narrateur évoque le jeu préféré de la petite fille qui aime que sa mère joue à « lui faire monstrueusement peur », celle-ci se penche grandement en avant en baissant ses bras tendus jusqu’au sol. Deux plans d’une action scénique coexistent ainsi pour se compléter en se concurrençant : le narrateur ne cesse de se déplacer et de regarder même certaines scènes mimées à l’aide de mouvements et gestes expressifs, parfois volontairement exagérés. Cette double action est relevée par des sons à caractère figuratif, comme ce bruit de pas en talon aiguille de la mère affairée ou ce gazouillement que l’on entend au moment du départ du Petit Chaperon rouge. Le jeu figuratif de la petite fille et de sa mère se trouve peu à peu comme propulsé vers les spectateurs jusqu’à la rencontre clé avec le loup lors de laquelle le narrateur se retire pour laisser parler les personnages. Tout est théâtralisé de telle sorte que l’action scénique s’impose à notre esprit avec une plus grande authenticité dans la mesure où elle semble commandée par le narrateur qui sert d’intermédiaire entre les spectateurs assis dans la salle et le monde imaginaire amené sur scène grâce à son récit.

L’effet produit sur les spectateurs est prodigieux, mêlé d’enchantement, d’étonnement, de compassion et de frayeur. Si ceux-ci peuvent, au premier abord, se sentir déboussolés par la présence du narrateur et par l’ampleur de ses prises de parole, ils se laissent progressivement séduire par la beauté des tableaux dont ils n’aperçoivent parfois que des contours flous, ce qui stimule d’autant plus leur imagination. Plusieurs mouvements et gestes semblent évoquer directement leur monde de références, tandis que l’action scénique des personnages ne lui en offre que des reflets grâce à un subtil jeu de lumière, le plus souvent concrétisé au sol. Un joli tapis de fleur obtenu par l’éclairage s’étend ainsi sur le plateau lors de la scène du flan et lors de celle du départ du Petit Chaperon rouge, ce qui se traduit par une redoutable impression de satisfaction par rapport à ce qui l’attend. La plus spectaculaire et la plus fascinante est l’apparition du loup, dont on distingue à peine les traits. L’éclairage au sol, sous forme d’une longue file de lumière dirigée vers la petite fille, a pour effet que le loup reste voilé dans une semi-obscurité énigmatique en passant, selon les propos du narrateur et la fascination de la petite fille, pour quelque chose de beau. C’est dans cette scène que la frayeur, au regard de l’action à venir, se mêle curieusement à l’enchantement produit par la féerie du tableau.
L’adaptation du Petit Chaperon rouge par Joël Pommerat est donc une incontestable réussite dramaturgique : il n’est pas seulement question de l’histoire et de son remaniement, il s’agit aussi et surtout de l’esthétique théâtrale mise en œuvre par le metteur en scène pour rendre cette histoire à son public, que celui-ci soit enfantin et adulte. Cette esthétique théâtrale, éprouvée dans Le Petit Chaperon rouge, traverse tout son œuvre reçu avec un enthousiasme grandissant. La reprise de ce conte n’en est ainsi qu’une sublime étape qui s’est soldée par des spectacles époustouflants.
 Jouée actuellement au Théâtre de la Reine-Blanche (
Jouée actuellement au Théâtre de la Reine-Blanche (