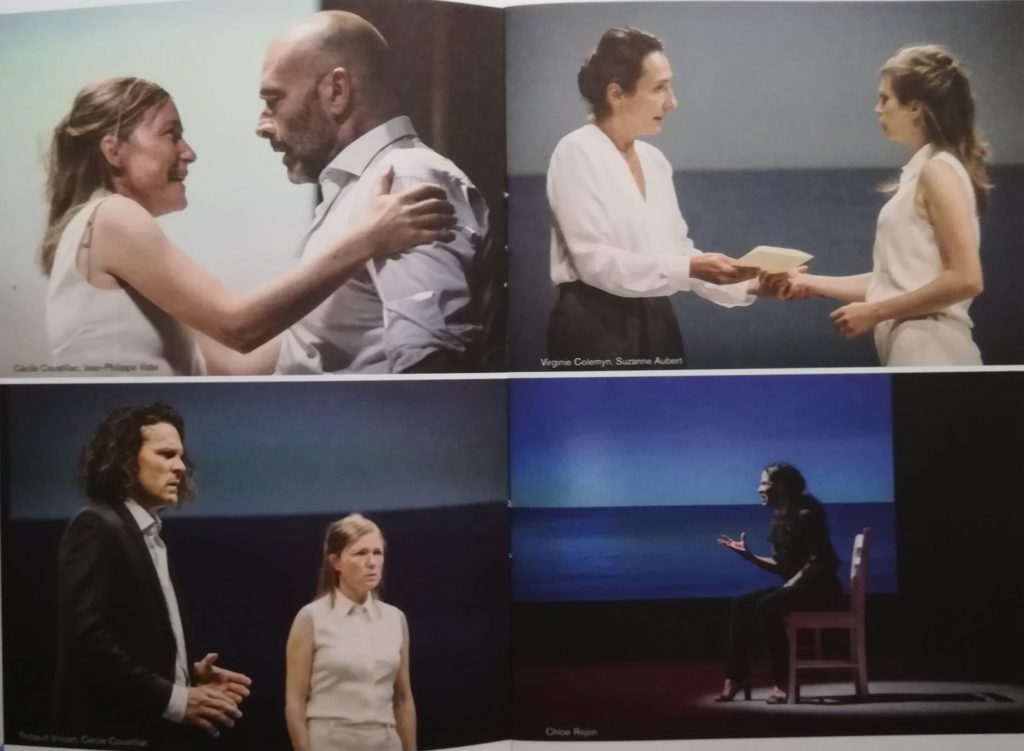Le Grand Inquisiteur, actuellement joué à l’Odéon-Théâtre de l’Europe, est une libre adaptation, par Sylvain Creuzevault, d’un chapitre de la deuxième partie des Frères Karamazov de Dostoïevski (>).
Ce n’est pas la première fois que Sylvain Creuzevault s’attaque à l’œuvre de Dostoïevski dont il propose une relecture personnelle qui ne convainc pas. Après Les Démons, il débarque, cette fois-ci, avec Le Grand Inquisiteur qui doit être une sorte de préambule aux Frères Karamazov à l’affiche de l’Odéon après les vacances d’automne. Il veut faire du théâtre politique et satirique à la lumière des idées du grand auteur russe, mais ses adaptations passent mal à l’épreuve de la scène et indignent certains spectateurs. Ce n’est pas qu’il soit interdit de « choquer » au théâtre en montrant des scènes violentes et farcesques. Au début du XXIe siècle, on a déjà tout eu et on est habitué à ce que l’art se saisisse de tout type de sujet et qu’il aborde tout type de problème. La question ne se pose pas en termes de décence et d’indécence, comme c’était par exemple le cas au XIXe siècle où l’exposition de la pauvreté ou du milieu défavorisé était considérée par la bourgeoisie bien-pensante comme moralement inconvenante. Vouloir ébranler les consciences ne tient pas au choix d’un sujet polémique et à sa représentation déjantée : vouloir ébranler les consciences relève de l’art et d’une manière très subtiles qui ne sont pas donnés à tout un chacun. C’est une démarche délicate qui doit être maniée avec intelligence pour ne pas agacer par une platitude formelle. On a récemment pu le voir dans les mises en scène d’Ivo van Hove (Les Damnés et Électre/Oreste créées à la Comédie-Française) qui produisent un effet de sidération parce que la violence y est sublimée au travers d’une élégance supérieure de l’action scénique. C’est qu’Ivo van Hove soumet un sujet heurtant les sensibilités au travail de la mise en scène qui en dévoile les aspects les plus terribles sans basculer dans la caricature ou le ridicule. Comme la teneur du mal est structurelle au sujet et à sa transposition scénique, la violence surgit simultanément sur les deux plans. C’est cet équilibre qui semble la clé de la réussite des metteurs en scène les plus audacieux. Il est maintes fois brisé dans Le Grand Inquisiteur de Sylvain Creuzevault qui ne réussit ni à faire rire les spectateurs ― si c’était son but ? ― ni à les tenir en haleine. Mais ce n’est pas la seule représentation éhontée d’un sujet polémique qui est déplaisante : l’ensemble de la mise en scène manque de cohérence, de profondeur et d’intérêt, ne permettant pas de laisser apprécier le questionnement existentiel posé par le poème d’Ivan Karamazov « Le Grand Inquisiteur ».
Le Grand Inquisiteur a beau être tiré des Frères Karamazov pour interroger le rapport à la mort, la liberté et le bonheur des hommes, ce chapitre éponyme du roman de Dostoïevski ne sert en réalité que de point de départ pour une action fondée sur des raccourcis qui condensent opportunément quelques pans de l’Histoire moderne. Certains faits et certains personnages historiques doivent ainsi éprouver la prophétie d’un inquisiteur espagnol du XVIe siècle sur les excès de certaines idéologies à venir, telles que le communisme ou le nazisme, qui ont durablement marqué le XXe et le XXIe siècle. Pour ce faire, il fallait d’abord éliminer Jésus-Christ (et Dieu avec lui) comme l’annonce le Grand Inquisiteur qui contribue à instaurer un ordre contraignant mais rassurant pour les hommes angoissés devant la liberté prêchée par le messie chrétien. Le Grand Inquisiteur, vêtu d’une coule claire, prononce, mot à mot, le long réquisitoire récité par Ivan à son frère Aliocha, réquisitoire qui vaut la condamnation au bûcher de Jésus redescendu sur Terre, libéré in extremis par son accusateur qui le laisse partir. Cette longue scène quasi statique a lieu dans une pièce de monastère romanesque aux murs blancs et à de petites fenêtres à arc brisé, ce qui évoque d’emblée l’Espagne du XVIe siècle. Ce même espace scénique embrasse toute l’action qui s’ensuit, comme si l’Histoire moderne devait s’aligner sur le discours du Grand Inquisiteur : seuls quelques pièces mobiles et accessoires et les costumes d’époque des personnages historiques viendront le compléter symboliquement selon les périodes introduites. À commencer par l’apparition extravagante de Donald Trump accompagné de Margaret Thatcher, habillée dans un tailleur rose foncé kitch. Cette scène caricaturale tourne d’abord gratuitement en ridicule les deux politiques à l’aide de clichés bas de gamme. Elle prend un nouvel envol lors de la mise à mort de Jésus à travers un interminable festin « anthropophage ». Donald Trump et Margaret Thatcher s’amusent en effet à enfoncer des bâtons dans les fesses de Jésus pour en retirer des tripes et s’en nourrir. Ils semblent ensuite l’émasculer tout en continuant à festoyer aux regards ébahis d’un pape et d’un Joseph Staline qui ne manquent pas de mettre la main à l’ouvrage. Cette scène, dégoûtante, s’achève lorsque le corps massacré de Jésus disparaît du plateau dans une sorte de trappe. N’en déplaise à l’imagination débordante de Sylvain Creuzevault, ce choix dramaturgique se solde par un effet farcesque pitoyable qui plombe sa mise en scène tout en la dégradant à une sotte provocation. On n’a franchement pas envie de voir la suite de l’action placée sous le signe d’une gratuité dérisoire et abjecte. Comment, dans ces conditions, prendre au sérieux l’interrogation politico-métaphysique soulevée par le poème d’Ivan et menée jusqu’à l’émergence de Donald Trump ?
Plusieurs aspects de l’histoire de la pensée occidentale se superposent en se mêlant les uns aux autres sous les yeux d’un pape fêlé présent sur scène tout au long de l’action. Si ses interventions restent restreintes, on ne comprend pas très bien si ce pape est tenu de cautionner formellement les propos scandaleux du Grand Inquisiteur ou si sa démence doit ridiculiser les abus et la vacuité de l’église catholique. Les trois thèmes évoqués ― le rapport à la mort, la liberté donnée aux hommes par Jésus et la question du bonheur ― traversent tous les propos réunis avec maladresse, que ce soit lors d’un interrogatoire farfelu de Marx ou lors des discours d’Heiner Müller, d’Hitler ou de Trump. Si on décèle un certain fil conducteur qui fait chaotiquement parler des personnages hétérogènes plus pour les rabaisser, quoi qu’on en pense, que pour aller au cœur de leur pensée, c’est au prix des simplifications plates qui noient les spectateurs dans une farce mal ficelée. D’une prétendue réflexion politico-métaphysique, il ne reste, en fin de compte, que des actes qui dégoûtent, des mots qui sonnent creux et des idées mal organisées qui ressemblent à une dissertation potache.
Toutes les questions posées dans Le Grand Inquisiteur de Sylvain Creuzevault semblent soulever des enjeux mille fois abordés et dépassés à notre époque. Il en va ainsi, par exemple, pour ceux du communisme qui renvoient aux débats menés il y a quelques décennies et qui n’intéressent plus que quelques radicaux. L’étoile rouge et le visage de Staline taillé dans la pierre sont des survivances d’une époque reléguée désormais dans des manuels d’histoire. Quel intérêt de ressortir de telles idées surannées dans une mise en scène ridicule qui ne parvient pas à instaurer une réflexion politico-métaphysique avec sérieux ? Si un tel patchwork doit représenter la satire de la pensée occidentale sur la place de l’homme en proie aux régimes totalitaires et à la mondialisation uniformisante, Le Grandeur Inquisiteur imaginé par Sylvain Creuzevault ne fait que sourire à la vue des parades ubuesques qui détonnent avec les idées et les personnages convoqués. Ça se réduit à un pot-pourri qui mélange, avec anarchie, autant d’époques et personnages historiques que d’idées et idéologies dans une mise en scène laide. Il choque le spectateur comme Ivan choque Aliocha qui conteste aussitôt le bon sens du poème de son frère et la vraisemblance des propos du Grand Inquisiteur.
Le Grand Inquisiteur de Sylvain Creuzevault présentée à l’Odéon est une création ratée. Si on a vu quelques spectateurs applaudir par politesse, d’autres ont attendu la fin, les bras croisés, pour oublier cette mauvaise soirée passée à l’Odéon. On se demande lesquels reviendront en novembre pour voir Les Frères Karamazov…