Metteur en scène mythique, Georges Lavaudant présente, au Théâtre de la Ville, une nouvelle création du Roi Lear (>). C’est sa troisième version de cette célèbre tragédie de Shakespeare dont le rôle-titre revient cette fois-ci à Jacques Weber. Elle est jouée hors les murs, au Théâtre de la Porte Saint-Martin, dans une mise en scène épurée dont les rouages ne manquent pas de faire un délicieux froid dans le dos. Le pari gagné de Georges Lavaudant dans cette troisième version du Roi Lear tient à une sobriété scénographique qui induit une impressionnante manipulation de l’espace et de la lumière et qui invite ainsi les comédiens à déployer leur talent sur un plateau quasi nu.
Les tragédies de Shakespeare ne cessent de nourrir notre imaginaire malgré leur caractère historiquement daté. Elles portent souvent sur scène l’histoire d’un roi déchu, violemment confronté aux affres du pouvoir dont les rênes lui tombent des mains, à cause du défaut d’excès ou le péché d’hybris. Dans le cas de Lear, cette démesure se cristallise dans une trop grande confiance suscitée par un amour paternel aveugle, non payé en retour en raison d’une double volonté de puissance qui rompt radicalement avec les règles du jeu fondées sur l’honnêteté et la gratitude. La déception de Lear, trahi par ses deux filles aînées, le conduit non seulement à une déchéance matérielle et physique, mais aussi à une flétrissure morale et intellectuelle aux allures de folie. Le déchirement émotionnel qui en découle est doué d’une dimension humaine propre à l’expérience de tout un chacun, mais situé dans un univers délétère qui concentre spectaculairement les plus hautes ambitions politiques, il se charge d’une résonance étourdissante qui subjugue l’esprit par le dévoilement minutieux de la noirceur la plus repoussante de plusieurs perfidies orchestrées en cascade. La force du Roi Lear qui fait son succès depuis des siècles repose sur cette confrontation brutale d’un roi fondamentalement bon, mais non sans défauts, à un entourage familial noyé dans une hypocrisie viscérale qui se solde par une série de morts non manichéennes.
L’aménagement de l’espace scénique doit évoluer naturellement au cours de la représentation suivant le déroulement de l’action découpée en actes et en scènes sans respecter l’unité de lieu : au regard de cet enjeu dramaturgique typique de l’esthétique baroque, la sobriété scénographique arrêtée pour la mise en scène de Georges Lavaudant favorise d’emblée des changements fluides et efficaces de manière à rendre opaque le découpage en actes. Ce faisant, elle semble mettre sur le même pied d’égalité les scènes publiques et privées, soigneusement distinguées sur un plateau aménagé selon la dramaturgie élisabéthaine, comme si elles devaient toutes se valoir pour converger avec une plus grande limpidité au même dénouement à la fois tragique et libérateur. Quelques rares scènes d’intérieur ont simplement lieu devant une toile blanche baissée au milieu du plateau, ce qui accentue leur côté intime. Si un certain découpage continue, malgré tout, à structurer l’action scénique au regard des entrées et des sorties des personnages, il se dilue dans une musique classique de fond qui retentit à ces moments-là pour renforcer le sentiment de l’angoisse qui se dégage de la teneur glaçante des propos.
La scénographie tend ainsi à abolir toute idée de hiérarchie en soulignant l’unité organique et indivisible de l’action dramatique : qu’ils soient princes, ducs, ou bâtards, tous les « méchants » montrent qu’ils se valent lorsqu’ils perturbent l’ordre établi sur la loyauté, l’équité et la fidélité. Le même espace scénique se transforme ainsi a minima à l’aide de quelques décors et accessoires pour s’imposer comme une arène ou un champ de bataille des passions qui dominent les personnages.

Au lever du rideau, la scène représente de façon symbolique la salle du trône où a lieu la délibération sur la passation de pouvoir entre Lear et ses trois filles : un grand tapis rouge déroulé sur le devant de la scène d’un bout à l’autre, quatre chaises en bois dont l’une recouverte par un manteau d’hermine et précédée d’une table basse, un vidéo projecteur placé sur un support pyramidal qui est censé montrer les territoires partagés par Lear. Réutilisé à plusieurs reprises, notamment à l’occasion des scènes de délibération, l’éclairage latéral venant du côté cour confère à cette première grande scène une ambiance maléfique renforcée par la coloration gris-vert d’un sol éclatant.
Il en va de même lors de la scène où Edmund réussit à tromper son père, duc de Gloucester, sur les intentions faussement parricides de son frère. Cette scène, comme celle dans laquelle le bâtard Edmund expose opportunément ses motifs à travers un monologue saisissant, se déroule sur un plateau entièrement vide en accentuant discrètement son côté théâtral. S’il s’agit bien de « démasquer » la prétendue trahison d’Edgard, la porte de fond à deux battants, les costumes ― Edmund est par exemple habillé d’une chemise blanche, les manches retroussées, et d’un pantalon noir soutenu par des bretelles blanches ―, la nudité criarde de la scène et une luminosité tamisée tirant sur le gris pour contraster avec le fond noir donnent l’impression que les personnages se trouvent paradoxalement sur un plateau de cirque dégagé et que toute tromperie est ainsi une affaire de mots et de postures. Les scènes de falaise se passent également de tout élément de décor particulier pour livrer Lear, mais aussi Gloucester, à une misère existentielle soulignée à travers une nudité éclatante mise en valeur par l’éclairage : la parole, le geste et les haillons dont ils sont vêtus confèrent à leur détresse une résonance métaphysique très forte.

Deux moments charnières introduisent cependant dans cette scénographie épurée des effets spectaculaires obtenus grâce à une lumière éblouissante : l’éclat d’un orage, quand Lear devient fou, et la bataille finale, qui conduit au dénouement. S’ils frappent par leur intensité lumineuse, mais aussi sonore, ils sont courts et restent efficaces pour marquer des points de rupture dans l’action. Les déchets tombés des cintres, répandus sur le sol pendant la bataille, rompent dans le même temps avec le début policé de la scène située dans la salle du trône, mais aussi avec la sobriété décorative : ils engloutissent symboliquement Lear mort dedans tout en signifiant par-là l’écroulement définitif de l’ancien ordre bouleversé par des rivalités fratricides. Dans la mise en scène de Georges Lavaudant fondée sur un habile jeu de lumière, tout élément matériel introduit se charge ainsi d’une valeur expressive tout en se détachant avec force sur un fond dépouillé.
C’est ainsi que le jeu des comédiens gagne en expressivité, dans la mesure où leurs mouvements et gestes doivent s’approprier l’espace à chaque nouvelle scène pour lui donner une signification. Ils s’acquittent de leur rôle avec bravoure, certains d’entre eux étant amenés à en endosser plusieurs et à créer ainsi des personnages épisodiques. L’ensemble a pourtant l’air cohérent et synchronisé. Si le roi Lear de Jacques Weber concentre les regards, d’autres rôles ne manquent pas d’offrir d’excellentes occasions pour briller. Thibault Vinçon, dans celui d’Edgard, s’empare du sien avec souplesse : il convainc avec aisance notamment à travers son double jeu lorsqu’Edgard, déguisé en mendiant, fait semblant d’être fou pour aider Lear et son père, mais aussi pour venger son déshonneur. Astrid Bas, comme Goneril, crée une intrigante féroce dont la posture imposante et le regard assassin collent à merveille à cette fille aînée de Lear. Manuel Le Lièvre se distingue, quant à lui, dans le rôle d’un fou truculent, haut en couleur, grâce au sens de la repartie placé avec justesse non seulement sur le plan de la parole, mais aussi à travers des parades chantées qui suscitent le rire. Babacar M’Baye Kall incarne Kent avec une assurance équilibrée. François Marthouret apparaît dans le rôle de Gloucester en soulignant avec élégance la faiblesse touchante de son caractère. Jacques Weber, enfin, crée un Lear d’une prestance indétrônable mais nuancée en variant adroitement les tons : il réussit en particulier à maintenir le doute sur la folie du roi ébranlé dans son amour paternel, si bien que le spectateur ne sait pas si Lear fait semblant d’être fou ou si et à quel moment il le devient vraiment.
Georges Lavaudant propose, dans cette troisième version du Roi Lear, une nouvelle relecture tout à fait convaincante et saisissante : il met l’accent sur le jeu des comédiens en libérant le plateau de décors inutiles et en misant sur des effets de lumière, ce qui lui permet de ménager quelques moments intenses pour laisser ensuite les comédiens porter le poids du destin de Lear et de son entourage royal.


 séducteur Algernon Moncrieff connu dans la haute société londonienne pour ses aventures galantes et pour sa propension à l’oisiveté, mais aussi à travers celui de Jack Worthing qui s’est créé une double identité pour préserver sa réputation quand il a envie de sortir à Londres pour se délasser de la campagne où il vit avec sa pupille. L’intrigue renferme en outre une scène de reconnaissance on ne peut plus romanesque dans la mesure où l’action conduit in extremis à la révélation de la naissance de Jack Worthing considéré comme un orphelin parce qu’autrefois trouvé dans un sac de voyage à la gare Victoria : sa reconnaissance comme le fils égaré de la sœur de Lady Bracknell et par-là comme le frère aîné d’Algernon permet en effet de dénouer l’action avec une double promesse de mariage. Cette action est dans le même temps soutenue par l’aspiration des deux jeunes hommes devenus amis à se marier selon le choix de leur cœur, alors qu’ils rencontrent un fâcheux obstacle dans les convictions nobiliaires de Lady Bracknell farouchement attachée à préserver la pureté de son rang social. Mais l’intérêt de la pièce d’Oscar Wild ne repose pas entièrement sur la disposition de cette intrigue érotico-galante qui brasse avec virtuosité plusieurs traditions comiques : son ingéniosité tient précisément à l’imprégnation de l’action dramatique par une forme d’humour mordant, prétendument « british », qui paraît totalement désinvolte et qui ne manque pas de tourner copieusement en ridicule tous les clichés de la société anglaise. C’est sans doute dans la manipulation et le dosage de cet humour mordant que réside la réussite d’une mise en scène de L’Importance d’être constant : une pièce trop bien faite, tant au niveau de l’inventio et du dispositio que sur le plan de l’elocutio, n’attend de fait pour être jouée que la mise en place d’un rythme entraînant soutenu par l’habileté d’un jeu comique. C’est exactement ce qu’a réussi à trouver Arnaud Denis entouré d’excellents comédiens qu’il dirige avec une justesse extraordinaire.
séducteur Algernon Moncrieff connu dans la haute société londonienne pour ses aventures galantes et pour sa propension à l’oisiveté, mais aussi à travers celui de Jack Worthing qui s’est créé une double identité pour préserver sa réputation quand il a envie de sortir à Londres pour se délasser de la campagne où il vit avec sa pupille. L’intrigue renferme en outre une scène de reconnaissance on ne peut plus romanesque dans la mesure où l’action conduit in extremis à la révélation de la naissance de Jack Worthing considéré comme un orphelin parce qu’autrefois trouvé dans un sac de voyage à la gare Victoria : sa reconnaissance comme le fils égaré de la sœur de Lady Bracknell et par-là comme le frère aîné d’Algernon permet en effet de dénouer l’action avec une double promesse de mariage. Cette action est dans le même temps soutenue par l’aspiration des deux jeunes hommes devenus amis à se marier selon le choix de leur cœur, alors qu’ils rencontrent un fâcheux obstacle dans les convictions nobiliaires de Lady Bracknell farouchement attachée à préserver la pureté de son rang social. Mais l’intérêt de la pièce d’Oscar Wild ne repose pas entièrement sur la disposition de cette intrigue érotico-galante qui brasse avec virtuosité plusieurs traditions comiques : son ingéniosité tient précisément à l’imprégnation de l’action dramatique par une forme d’humour mordant, prétendument « british », qui paraît totalement désinvolte et qui ne manque pas de tourner copieusement en ridicule tous les clichés de la société anglaise. C’est sans doute dans la manipulation et le dosage de cet humour mordant que réside la réussite d’une mise en scène de L’Importance d’être constant : une pièce trop bien faite, tant au niveau de l’inventio et du dispositio que sur le plan de l’elocutio, n’attend de fait pour être jouée que la mise en place d’un rythme entraînant soutenu par l’habileté d’un jeu comique. C’est exactement ce qu’a réussi à trouver Arnaud Denis entouré d’excellents comédiens qu’il dirige avec une justesse extraordinaire.
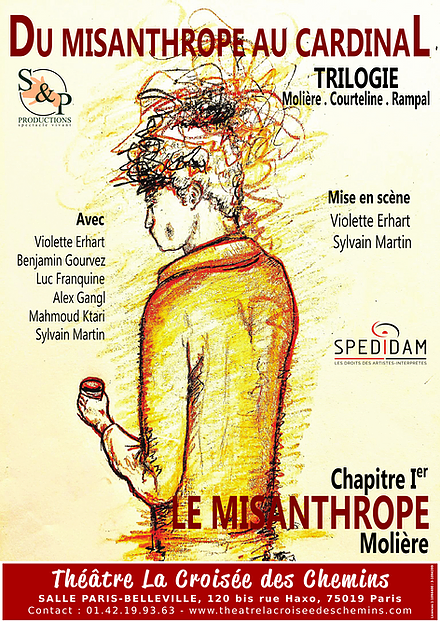



 est par ailleurs celle d’un mariage fâcheux conditionné par un héritage. Un marquis doit se marier avec une certaine Hortense ou lui payer deux cent mille écus, alors qu’il aime une comtesse à laquelle il ne parvient pas à déclarer son amour en bonne et due forme à cause de sa timidité chronique. Les vues d’Hortense portent sur un chevalier sans que la jeune femme éprouve la moindre attirance pour le marquis. Pour l’un comme pour l’autre se pose alors la question de l’héritage auquel aucun des deux ne veut renoncer. Les deux personnages sont ainsi amenés à se donner une comédie en faisant semblant de consentir au mariage dans l’espoir que l’autre finira par sacrifier sa part. Deux domestiques qui s’en mêlent à leur manière ne manquent pas de mettre leur grain de sel à cette comédie de dupes pour embrouiller leur maître sur le plan sentimental.
est par ailleurs celle d’un mariage fâcheux conditionné par un héritage. Un marquis doit se marier avec une certaine Hortense ou lui payer deux cent mille écus, alors qu’il aime une comtesse à laquelle il ne parvient pas à déclarer son amour en bonne et due forme à cause de sa timidité chronique. Les vues d’Hortense portent sur un chevalier sans que la jeune femme éprouve la moindre attirance pour le marquis. Pour l’un comme pour l’autre se pose alors la question de l’héritage auquel aucun des deux ne veut renoncer. Les deux personnages sont ainsi amenés à se donner une comédie en faisant semblant de consentir au mariage dans l’espoir que l’autre finira par sacrifier sa part. Deux domestiques qui s’en mêlent à leur manière ne manquent pas de mettre leur grain de sel à cette comédie de dupes pour embrouiller leur maître sur le plan sentimental. siècle. Et il est vrai qu’elle dénonce bel et bien les abus des maîtres en proie à une vie mondaine effrénée qui fait d’eux de véritables « tyrans » à maints égards. Pour les « corriger », c’est aux valets de leur tendre un miroir (déformant) en prenant leurs habits et en les plaçant à leur tour dans une position de serviteur. Mais comme le goût du XVIIIe pour le jeu veut que cet échange fait à la suite d’un naufrage ne bascule pas dans la violence, tout se passe dans une ambiance enjouée propre à l’univers dramatique de la Comédie-Italienne : selon les mots de Trivelin qui insiste sur des conditions de vie policées sur l’île, les maîtres, sans être tués, sont simplement tenus dans l’esclavage jusqu’à une reconnaissance cathartique de leurs travers. C’est ainsi que tout peut en fin de compte rentrer dans l’ordre social éprouvé et que chaque personnage finit par retrouver le statut qui était le sien à Athènes, c’est-à-dire dans la hiérarchie de la société du XVIIIe siècle : le déplacement spatial ne trompe aucun spectateur d’époque quant à la substitution de Paris à la capitale grecque. L’introduction d’Arlequin et du procédé du théâtre dans le théâtre confèrent en même temps à L’Île des esclaves une dimension résolument comique : tourner en ridicule les défauts des maîtres à travers une situation de jeu de rôles fondée avant tout sur la maladresse et sur l’innocence des serviteurs. Mais cette configuration n’empêche pas d’autres lectures de la pièce qui conduisent à ses nouvelles créations scéniques susceptibles d’interroger le texte selon des perspectives variées.
siècle. Et il est vrai qu’elle dénonce bel et bien les abus des maîtres en proie à une vie mondaine effrénée qui fait d’eux de véritables « tyrans » à maints égards. Pour les « corriger », c’est aux valets de leur tendre un miroir (déformant) en prenant leurs habits et en les plaçant à leur tour dans une position de serviteur. Mais comme le goût du XVIIIe pour le jeu veut que cet échange fait à la suite d’un naufrage ne bascule pas dans la violence, tout se passe dans une ambiance enjouée propre à l’univers dramatique de la Comédie-Italienne : selon les mots de Trivelin qui insiste sur des conditions de vie policées sur l’île, les maîtres, sans être tués, sont simplement tenus dans l’esclavage jusqu’à une reconnaissance cathartique de leurs travers. C’est ainsi que tout peut en fin de compte rentrer dans l’ordre social éprouvé et que chaque personnage finit par retrouver le statut qui était le sien à Athènes, c’est-à-dire dans la hiérarchie de la société du XVIIIe siècle : le déplacement spatial ne trompe aucun spectateur d’époque quant à la substitution de Paris à la capitale grecque. L’introduction d’Arlequin et du procédé du théâtre dans le théâtre confèrent en même temps à L’Île des esclaves une dimension résolument comique : tourner en ridicule les défauts des maîtres à travers une situation de jeu de rôles fondée avant tout sur la maladresse et sur l’innocence des serviteurs. Mais cette configuration n’empêche pas d’autres lectures de la pièce qui conduisent à ses nouvelles créations scéniques susceptibles d’interroger le texte selon des perspectives variées.