Le Faiseur de théâtre (Der Theatermacher, 1984) est une pièce polémique de l’autrichien Thomas Bernhard devenu célèbre pour la teneur acérée de ses textes à l’encontre du conformisme et de la bien-pensance qu’ils dénoncent avec virulence. Le Faiseur de théâtre, quant à lui, s’en prend à l’art dramatique et ses conventions. Au théâtre Poche-Montparnasse (>), Chantal de La Coste s’en saisit avec finesse pour en proposer une mise en scène dynamique qui donne du poids au propos de Bruscon brillamment incarné par Hervé Briaux.
Si Le Faiseur de théâtre est l’une de ces pièces métathéâtrales qui nous laissent pénétrer dans les coulisses de la fabrique du théâtre, elle compte parmi les moins conventionnelles, dans la mesure où elle est loin de le célébrer dans ses missions culturelles ou de détourner son fonctionnement sur un ton burlesque. La pièce de Thomas Bernhard dresse le portrait cruel d’un directeur de théâtre aussi bien renfermé dans une autosuffisance inflexible que replié sur une logique argumentative imprégnée des stéréotypes sociaux les plus orthodoxes. La pensée implacable de ce directeur qui aspire à la grandeur se dévoile au travers d’un faux dialogue mené avec un aubergiste comme avec ses deux enfants qu’il n’arrête pas de rabaisser tout en les amenant à jouer dans sa comédie. Il ne s’agit pas d’un jeu plaisant qui mette les personnages dans des situations embarrassantes pour éprouver leurs sentiments ou leurs performances à la manière des Acteurs de bonne foi de Marivaux. Bruscon représente la démonstration en force d’une vision de grandeur néfaste et stérile, et remet par-là en cause les défaillances du monde de théâtre, son fonctionnement autocratique et son impuissance à susciter l’intérêt des masses.

L’action du Faiseur de théâtre évoque l’univers de théâtre de manière détournée en se situant non pas sur une scène de théâtre, mais dans l’auberge d’un village perdu au fin fond de rien : c’est là que Bruscon doit donner sa pièce La Roue de l’Histoire, à l’aide de sa troupe ambulante composée des membres amateurs de sa famille, devant à peu près deux cents spectateurs constitués de simples villageois, plus intéressés à l’élevage du porc qu’aux subtilités de la philosophie de Kierkegaard mentionné au passage, et symboliquement représentés par l’aubergiste indifférent aux discours sur l’art. L’autosuffisance qui conduit Bruscon à se considérer comme l’un des plus grands hommes de théâtre de son temps détonne spectaculairement avec une ambiance sordide qui ne se prête en aucune façon à la représentation d’une grande fresque historique promise par sa pièce. L’action du Faiseur de théâtre se présente ainsi comme une superbe farce qui interroge ironiquement notre rapport aux rouages du théâtre soumis aux archétypes rigides des aspirations élitistes. Au regard de ses enjeux esthétiques, Chantal de La Costa a fait choix d’une mise en scène puissante aux accents naturalistes tout en se gardant de la faire basculer dans la dérision ou la caricature.
La scène représente la salle de restaurant de l’hôtel Au Cerf Noir à Utzbach en s’appuyant sur plusieurs éléments de décor réalistes, sans les multiplier pour autant à outrance pour préserver leur caractère factice propre à un subtil jeu de mises en abîme. Une porte d’entrée, à jardin, fait face à un plateau bar installé sous une arcade située à cour. Le fond de la scène figure une série de fenêtres recouvertes de rideaux clairs, sans doute en guise de vitres qui ne permettent pas de donner sur l’extérieur de façon authentique : cette fermeture énigmatique donne cependant l’impression que l’action du Faiseur de théâtre se déroule dans un endroit aussi retiré que caché, à cheval entre une réalité scénique concrète et une fiction dramatique virtuelle. Si une paire de tables en bois entourées de chaises symbolise la salle de restaurant, une estrade en lattes placée sur le devant de la scène la transforme tant soit peu en salle de bal attendue selon la didascalie initiale. Plusieurs portraits complètent cette scénographie figurative : celui d’un cochon et celui d’Adolf Hitler se font face sur une diagonale de cour à jardin en la subvertissant pour déjouer son caractère naturaliste et lui conférer in fine une dimension proprement théâtrale.

À l’entrée dans la salle, des grognements de cochon suggèrent l’ambiance du « néant culturel absolu » tout en renvoyant à plusieurs propos acerbes de Bruscon qui sera incommodé par l’odeur de porc. C’est ainsi qu’Hervé Briaux, dans le rôle du directeur, habillé de noir et muni d’une canne, entre en scène pour se retrouver face à Patrice Dozier, dans celui de l’hôtelier : un étrange échange se met en place entre celui qui ne cesse de parler de la création de son immense pièce et celui qui se contente d’écouter et de fournir des informations loufoques sur les habitudes alimentaires de son village. Hervé Briaux incarne son personnage en lui donnant une prestance dominante grâce à des mouvements et gestes assurés, mais aussi à travers une voix grave tétanisante. Malgré le caractère hargneux de Bruscon, Hervé Briaux ne crée pas un personnage monstrueux dérisoire : son assurance et le maintien distingué produisent un effet de frayer d’autant plus efficace qu’Hervé Briaux nous persuade que son Bruscon est intimement convaincu du bien-fondé de ses actes et propos tant oppressants qu’empreints d’idées de grandeur. Face à lui, Patrice Dozier incarne un hôtelier apathique en limitant ses mouvements et en se contentant de sourire, mais sans paraître le moins du monde intimidé par la présence vainement écrasante de Bruscon. À un moment donné, il se met significativement à hacher la viande avec une nonchalance désarmante. Un fin dialogue de sourds souligne ainsi tout en demi-teinte le caractère quasi absurde de cette farce métaphysique sur des bas et des hauts qui traversent l’art dramatique.
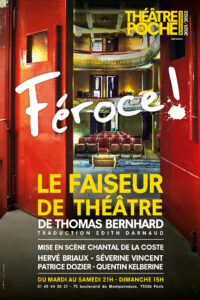 Mais l’action intègre également des scènes de théâtre dans le théâtre en rapport avec la création de la pièce de Bruscon : il s’agit notamment de répétitions faites avec la fille et le fils, copieusement humiliés par ce père cynique dont la rancœur se manifeste ici de la sorte conformément à ses propos misogynes et méprisants énoncés dans sa quête de l’absolu. Comme dans sa confrontation avec l’hôtelier, Bruscon d’Hervé Briaux garde le même sang-froid qui donne à son personnage une portée retentissante, alors que Séverine Vincent et Quentin Kelberine interprètent les deux enfants sans avoir l’air d’en souffrir. Le Faiseur de théâtre nous laisse ainsi pénétrer dans un univers féroce imprégné de tout type de préjugés et clichés prononcés sans gêne pour éprouver des valeurs négatives qui alimentent la propension de la bourgeoisie au mépris et à l’élitisme : « Seul un être cultivé est un être humain », déclarera Bruscon pour finir par constater que lui et sa famille ne jouent que pour s’améliorer et non pas pour « cette racaille de la campagne ». Si l’action et l’univers du Faiseur de théâtre paraissent à maints égards paradoxaux, ils restent pour autant parfaitement cohérents dans la mesure où ils tendent, sans aucune pitié, un miroir déformant aux archétypes de pensées de la bourgeoisie triomphante. L’équilibre obtenu entre la férocité du portrait dressé et sa représentation raffinée produit un puissant effet de sidération.
Mais l’action intègre également des scènes de théâtre dans le théâtre en rapport avec la création de la pièce de Bruscon : il s’agit notamment de répétitions faites avec la fille et le fils, copieusement humiliés par ce père cynique dont la rancœur se manifeste ici de la sorte conformément à ses propos misogynes et méprisants énoncés dans sa quête de l’absolu. Comme dans sa confrontation avec l’hôtelier, Bruscon d’Hervé Briaux garde le même sang-froid qui donne à son personnage une portée retentissante, alors que Séverine Vincent et Quentin Kelberine interprètent les deux enfants sans avoir l’air d’en souffrir. Le Faiseur de théâtre nous laisse ainsi pénétrer dans un univers féroce imprégné de tout type de préjugés et clichés prononcés sans gêne pour éprouver des valeurs négatives qui alimentent la propension de la bourgeoisie au mépris et à l’élitisme : « Seul un être cultivé est un être humain », déclarera Bruscon pour finir par constater que lui et sa famille ne jouent que pour s’améliorer et non pas pour « cette racaille de la campagne ». Si l’action et l’univers du Faiseur de théâtre paraissent à maints égards paradoxaux, ils restent pour autant parfaitement cohérents dans la mesure où ils tendent, sans aucune pitié, un miroir déformant aux archétypes de pensées de la bourgeoisie triomphante. L’équilibre obtenu entre la férocité du portrait dressé et sa représentation raffinée produit un puissant effet de sidération.




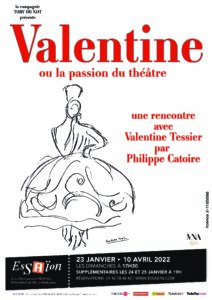 Valentine ou la passion du théâtre est une création de la compagnie Toby Or Not présentée au Théâtre de l’Essaïon dans une mise en voix sensible de Philippe Catoire (
Valentine ou la passion du théâtre est une création de la compagnie Toby Or Not présentée au Théâtre de l’Essaïon dans une mise en voix sensible de Philippe Catoire (




